

De plus, l'idée selon laquelle la concurrence est une bonne chose est relativement récente dans la pensée occidentale, et il lui arrive d'être contestée, notamment par les puissants groupements d'intérêts qui ont beaucoup à y perdre. D'un autre côté, la concurrence, quand on l'envisage du point de vue moral, est l'un des concepts les plus complexes de toute l'activité économique. Contrairement à la plupart des formes de malhonnêteté, d'exploitation et de dommages physiques, elle est légale, efficace et habituellement bénéfique, si bien que les problèmes éthiques s'en trouvent obscurcis et souvent difficiles à définir ou à approfondir. Une étude de la Halakha en la matière nous en apprendra beaucoup sur la manière de percevoir la concurrence. 
Le Talmud avance une discussion entre Rav Houna et Rav Houna le fils de Rav Yéhochoua'. Rav Houna pense qu'il est interdit au second d'ouvrir son commerce, en s'appuyant sur le cas du pêcheur. Rav Houna le fils de Rav Yéhochoua' pense au contraire, que c'est permis, et le 1er ne peut en aucun cas l'empêcher de l'ouvrir. En définitive, le Talmud conclut comme l'avis de ce dernier (cf. Tossefote début de citation " Péchita " qui explique que sa position est en harmonie avec l'opinion de la majorité dans un débat similaire à celui de l'époque des Tanaïm). Il ressort donc, selon le Talmud, que la libre concurrence est totalement permise, sans restriction aucune ! 
Comment faut-il comprendre cette mise en garde ? Doit-on comprendre qu'il s'agit là d'un problème éthique, à savoir que selon la loi stricte il n'y a aucun interdit à pratiquer une libre concurrence, mais d'un point de vue éthique je me dois de faire attention à ne pas dériver dans la concurrence déloyale. Ou bien, le Roi David ne nous soumet pas qu'une recommandation, mais qu'il s'agirait bien de Halakha, c'est à dire que la loi interdirait de pratiquer une concurrence effrénée ? Le problème selon cela est qu'il y aurait donc une contradiction avec l'opinion de Rav Houna fils de Rav Yéhochoua' qui pense que la libre concurrence est totalement permise ? La réponse est que ces 2 possibilités sont en fait 2 grandes approches évoquées par les commentateurs. Le Avi Assaf, un des auteurs du moyen âge (cité par le Mordékhi, Baba Batra 516, et Haga'hote Maïmoniote, Hilkhote Chékhénim 6:8), interdit l'ouverture d'un magasin à l'entrée d'un Mavoye Satoum (une rue en cul-de-sac), si un magasin similaire est déjà situé plus loin dans le Mavoye Satoum. Cette concurrence est injuste, car elle va certainement ruiner l'ancien commerçant. Les clients potentiels vont voir le nouveau magasin à l'entrée du Mavoye Satoum sans jamais remarquer l'autre magasin qui est situé plus loin ! Le Rama (voir le Darké Moché 156:4), ainsi que le 'Hatam Sofèr (cf. 'Hochèn Michpate 61 et 118, cité par le Pit'hé Téchouva 156 :3) expliquent que le Avi Assaf se base sur l'opinion de Rav Houna fils de Rav Yéhochoua' qui ne permet la concurrence que dans le cas où le second commerçant ne provoquera qu'une diminution des revenus du 1er magasin. Cependant dans le cas où l'ouverture de son magasin provoquera la faillite du 1er magasin, même Rav Houna interdira une telle concurrence !  Rav Moché Feinstein Pour conclure, le Rama (cf. Responsa 10) raconte qu'à son époque est arrivé un cas où une imprimerie tenue par des non Juifs avait imprimé une édition du livre de Maimonide, alors qu'une première imprimerie avait déjà éditée ce livre, ce qui menaçait cette entreprise de faire faillite, vu les moyens financiers beaucoup plus importants de l'imprimerie non juive. Le Rama, selon son avis cité plus haut, a alors tranché en faveur du 1er imprimeur (non pas parce qu'il était Juif et que le 2 me était non Juif, mais car il tranchait la loi selon l'opinion du Avi Assaf), et avait demandé aux gens de son époque de boycotter les livres de la seconde imprimerie. Cependant, il y a une 2ème approche, celle du 'Havote Yaïr (cf. Responsa 42) qui pense que cette mise en garde du Roi David n'est en fait qu'un problème d'éthique étant donné que la loi stricte permet la libre concurrence, par contre l'enjeu proposé par le Roi David est d'aller au delà de la loi, en signe de piété (cf. Le secret de la réussite). Cette conclusion est d'ailleurs corroborée par quasiment tous les grands décisionnaires, tels que le Rif, Maimonide, et particulièrement le Meïri qui rejette explicitement la restriction relative à l'établissement de nouveaux filets de pêche (citée plus haut), ce qui implique que selon lui il serait même permis de jeter ses filets juste en face du 1er pêcheur ! D'ailleurs, le Bèt Efraïm (cf. 'Hochèn Michpate 26-27), suivant cette opinion, écrit que la pratique courante au sein de sa communauté était d'autoriser à ouvrir de nouveaux hôtels à la porte de la ville, en dépit du fait qu'il y avait les anciens hôtels à l'intérieur de la ville. En résumé, il ressort donc que selon la plupart des décisionnaires la libre concurrence est permise selon la Tora.  Le 'Hatam Sofèr 1) Les monopoles nécessaires: Le 'Hatam Sofèr (79) émet l'opinion que les communautés devraient veiller à ce que certaines industries bénéficient d'une protection monopoliste. Le Rav Dr Aaron Levine (Free Enterprises and Jewish Law, p. 19-20) suggère que les compagnies d'électricité ou encore les transports urbains sont des exemples d'entreprises qui auraient besoin de ce genre de protection. Nous pouvons ajouter que les sociétés et les commerces de services Juifs dans des petites communautés sont encore un exemple. 2) L'enseignement de la Tora : Le Talmud (Baba Batra 21b-22a) affirme que même Rav Houna permet la libre concurrence dans ce domaine étant donné que cela favorise l'amélioration de la connaissance de la Tora (Kinate sofrim tarbé 'Hokhma). Cependant, il faut préciser ici que ce type de concurrence n'est permis exclusivement que dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement de la Tora, mais pas dans les autres domaines religieux. Le Rav Basri (Cha'aré 'Ezra 2 :131) donne l'exemple, à ce sujet, des Rabbanim qui procèdent à la vente du 'Hamèts la veille de Péssa'h et qui, pour ce faire, se font concurrence ! Pratique en fait interdite selon la Tora… 3) Les quartiers d'affaires : Beaucoup d'autorités contemporaines pensent qu'un nouveau magasin peut, selon les circonstances, améliorer l'activité de ses concurrents. Le nouveau magasin permet de transformer la zone en un centre pour un certain type d'entreprises. On pourrait citer en exemple le quartier du sentier pour le prêt-à-porter, la rue Meslay pour les chaussures, ou encore le 12ème arrondissement de Paris pour les équipements informatiques, et bien d'autres cas dans le monde. Ces zones attirent de grandes quantités de consommateurs, qui dépensent plus d'argent que s'il n'y avait qu'un seul magasin dans la rue, ce qui fait grandement bénéficier les premiers " arrivés ". 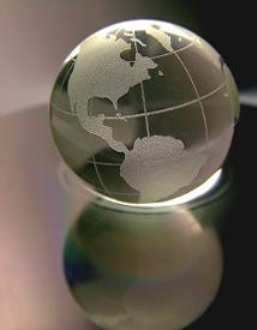
Pour donner un exemple, le Bèt Dine de Tel Aviv écrit que les compagnies d'assurance qui ne sont pas limitées à un endroit ne peuvent pas être contraintes aux même lois sur la concurrence qu'un commerce de quartier (Piské Dine Rabbanim). Suite à ce raisonnement, et en raison de la mondialisation et d'Internet en particulier, il y a énormément d'entreprises qui réalisent une grande, voire la totalité de leur activité en dehors de leurs propres limites géographiques. C'est pour cela que pour se prononcer au niveau de la concurrence il faut impérativement consulter un Rav décisionnaire, mais qui connaît aussi les rouages du monde de l'entreprise moderne ('Aroukh Hachou'hane 15,6). Rav Haim Sabbah, Directeur de l'Institut Tsedek. Centre de recherche sur l'ethique Juive des affaires |
